À l’ère du « like » éphémère et des tweets rageurs, la bienséance ; cet ensemble de règles régissant les interactions sociales, semble reléguée au rang de relique nostalgique. Pourtant, ces codes, qui ont structuré des siècles de vie collective, ne sont pas qu’un inventaire de contraintes désuètes. Ils incarnent un équilibre subtil entre respect d’autrui et affirmation de soi. Si les réseaux sociaux et l’individualisme ont brouillé les repères (un sondage IPSOS de 2022 révèle que 67 % des Français jugent les relations sociales « plus grossières » qu’il y a 20 ans), la bienséance n’a pas disparu : elle se réinvente. Cet article explore son héritage, ses défis contemporains, et sa possible renaissance.
Table of Contents
- 1 INTERVIEW
- 1.0.1 Dr. Élise Martin, sociologue spécialiste des réseaux sociaux
- 1.0.1.1 Question 1 : Les réseaux sociaux ont-ils tué la bienséance traditionnelle ?
- 1.0.1.2 Question 2 : L’anonymat en ligne encourage-t-il nécessairement la malveillance ?
- 1.0.1.3 Question 3 : Les plateformes comme Instagram ou X (Twitter) peuvent-elles imposer une “étiquette numérique” ?
- 1.0.1.4 Question 4 : Comment réinventer la bienséance pour le numérique ?
- 1.0.1.5 Question 5 : La “cancel culture” est-elle l’ennemie ou l’héritière de la bienséance ?
- 1.0.2 Author
- 1.0.1 Dr. Élise Martin, sociologue spécialiste des réseaux sociaux
Histoire des codes sociaux
Courtoisie médiévale vs salons littéraires du XVIIIe siècle
Au Moyen Âge, la courtoisie codifie les rapports entre chevaliers et dames, mêlant respect, galanterie et codes stricts (ex. l’interdiction de nommer directement une femme mariée). Les traités comme Le Livre des manières d’Étienne de Fougères (1877) enseignent l’art de « bien se tenir » à table ou en société.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les salons littéraires (ceux de Madame de Rambouillet ou de Julie de Lespinasse) transforment ces règles en un art de la conversation. La bienséance y devient un outil d’ascension sociale : savoir manier l’ironie sans offense, écouter avec grâce, éviter les sujets vulgaires. Voltaire écrit : « La politesse est à l’esprit ce que la grâce est au visage. »
Influence des religions : Bienveillance chrétienne et li confucéen
La bienséance puise aussi dans des traditions spirituelles :
- Le christianisme promeut la charité et l’humilité . Saint Benoît impose aux moines le silence pendant les repas pour éviter les conflits.
- En Chine, le li (rituel confucéen) régit les interactions hiérarchiques (ex. les prosternations devant l’empereur) et familiales. Confucius écrit : « Sans les rites, la courtoisie devient fatigante, la prudence timide. »
Ces systèmes fusionnent éthique et pragmatisme : éviter la violence, stabiliser l’ordre social.
Enjeux modernes
Réseaux sociaux : Trolls, harcèlement, et anonymat
L’anonymat numérique a libéré une parole brute. En 2021, une étude de Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking montre que 42 % des utilisateurs de Twitter ont subi des attaques personnelles. Les « trolls » exploitent la distance virtuelle pour transgresser sans conséquence , une dynamique que le sociologue Edgar Morin nomme « l’incivilité désinhibée ».
Pourtant, des contre-mouvements émergent :
- Le « mindful posting » (publication consciente) prône une réflexion avant de commenter.
- Les plateformes comme Instagram testent des alertes anti-harcèlement (ex. message suggéré : « Voulez-vous vraiment envoyer ceci ? »).
Monde professionnel : Codes vestimentaires hybrides (post-COVID)
Le télétravail a bouleversé les normes vestimentaires. En 2023, 55 % des entreprises européennes autorisent le « casual chic » au bureau (étude DressCode Report). Mais cette flexibilité génère des malaises :
- Cas emblématique : En 2022, un banquier londonien est renvoyé pour avoir participé à une visioconférence en t-shirt, malgré une productivité exemplaire.
- Les générations s’affrontent : les Millennials privilégient le confort, les Baby-boomers défendent le costume-cravate.
La bienséance moderne exige désormais de maîtriser des codes contextuels : pyjama acceptable en réunion Zoom interne, mais veste requise pour un client.
Études sociologiques
Impact de la bienséance sur la confiance (Harvard, 2019)
Une étude de la Harvard Business School a analysé 500 startups. Celles où les dirigeants pratiquaient une communication respectueuse (remerciements explicites, écoute active) avaient 2,3 fois plus de chances d’attirer des investisseurs. La bienséance y est perçue comme un marqueur de fiabilité.
Comparaison interculturelle : Japon vs Occident
- Au Japon, le tatemae (façade sociale) impose de masquer ses émotions négatives pour préserver l’harmonie. Exemple : Un employé critiqué répondra « Kenshō shimasu » (« Je vais réfléchir à cela »), même s’il est en désaccord.
- En France, le « franc-parler » est valorisé, mais des règles implicites persistent : ne pas interrompre son supérieur, éviter les sujets politiques en déjeuner d’affaires.
Un paradoxe émerge : les cultures asiatiques, perçues comme rigides, intègrent mieux les nouvelles normes (ex. codes de conduite en ligne), tandis que l’Occident lutte contre la polarisation.
Renaissance de l’étiquette ?
Mouvements slow living et manuels de savoir-vivre
Le slow living, popularisé par des auteurs comme Carl Honoré, réhabilite des pratiques ritualisées : repas sans écrans, lettres manuscrites. Les ventes de manuels d’étiquette ont bondi de 40 % entre 2020 et 2023 (source : Éditions Flammarion).
Rôle des influenceurs : Marie de Hennezel et le « care » numérique
La psychologue Marie de Hennezel, suivie par 250 000 personnes sur Instagram, poste des vidéos sur « l’élégance intérieure » : répondre aux critiques avec calme, pratiquer la gratitude. D’autres influenceurs comme @MisterManners (États-Unis) décryptent les protocoles professionnels modernes (ex. bien utiliser les emojis dans un e-mail).
Le retour du « face-à-face »
Face à la fatigue numérique, des entreprises organisent des « journées sans écran », où les salariés communiquent par notes écrites ou discussions en personne. Une tentative de réenchanter la bienséance par le tangible.
Conclusion
La bienséance n’est pas morte, elle mute. Hier encadrée par des traités stricts, elle se recompose aujourd’hui en réponse à l’hybridation du réel et du virtuel. Son enjeu n’est plus de dicter comment porter une fourchette, mais de répondre à une question cruciale : comment coexister sans se nuire dans un monde fragmenté ? Les solutions passent par un mélange de flexibilité (accepter le jogging en réunion) et de fermeté (sanctionner le harcèlement en ligne). En réinventant ses codes, la bienséance pourrait redevenir ce qu’elle fut toujours : un outil de liberté, non de contrainte.
INTERVIEW
Dr. Élise Martin, sociologue spécialiste des réseaux sociaux
Poste : Chercheuse au Laboratoire des Interactions Digitales (Sorbonne Université)
Question 1 : Les réseaux sociaux ont-ils tué la bienséance traditionnelle ?
Dr. Martin : « Dire qu’ils l’ont “tuée” serait simpliste. En réalité, ils l’ont détournée. Prenez l’exemple du “like” : à l’origine, c’était un geste de courtoisie numérique – un équivalent moderne du sourire en société. Mais aujourd’hui, il est devenu une monnaie d’échange anxieuse. Une étude que nous avons menée en 2023 montre que 58 % des 18-25 ans ressentent une pression à “aimer” les posts de leurs supérieurs hiérarchiques, même s’ils les trouvent insignifiants. La bienséance n’a pas disparu : elle s’est algorithmisée, avec ses codes implicites. Le problème, c’est que ces codes sont opaques et mouvants. »
Question 2 : L’anonymat en ligne encourage-t-il nécessairement la malveillance ?
Dr. Martin : « L’anonymat est un amplificateur, pas une cause. Dans nos travaux, nous observons que 70 % des “trolls” agressifs ont aussi des comportements irrespectueux hors ligne – mais l’absence de conséquences directes libère leur passage à l’acte. Prenez le cas des chatrooms japonaises : malgré l’anonymat, les insultes racistes y sont 3 fois moins fréquentes qu’en France. Pourquoi ? Parce que la culture du tatemae [masque social] imprègne même les espaces virtuels. L’enjeu n’est pas de bannir l’anonymat, mais de recréer des garde-fous culturels. »
Question 3 : Les plateformes comme Instagram ou X (Twitter) peuvent-elles imposer une “étiquette numérique” ?
Dr. Martin : « Leurs tentatives sont ambivalentes. D’un côté, les alertes “Voulez-vous vraiment publier ceci ?” réduisent les messages haineux de 15 % selon Meta. De l’autre, leurs algorithmes récompensent souvent la polémique – une insulte génère 2,4 fois plus d’engagement qu’un commentaire constructif. La modération automatisée reste aveugle aux nuances. Un de mes étudiants a mené une expérience : il a posté une citation de Voltaire “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire”. Résultat ? Le post a été flaggé pour “incitation à la violence” par un bot. La technologie seule ne suffit pas. »
Question 4 : Comment réinventer la bienséance pour le numérique ?
Dr. Martin : « En s’inspirant du passé. Au XVIIIe siècle, les salons littéraires avaient des règles strictes : on ne coupait pas la parole, on évitait les attaques ad hominem. Pourquoi ne pas transposer cela en ligne ? Des communautés Reddit comme r/AskHistorians bannissent les réponses non sourcées – leur bienséance est fondée sur le respect des faits. Par ailleurs, les jeunes générations inventent leurs propres codes : l’ajout d’emojis apaisants (🌱✨) après un désaccord, ou le “trigger warning” [avertissement de contenu sensible] pour préserver l’interlocuteur. La bienséance de demain sera choisie, non imposée. »
Question 5 : La “cancel culture” est-elle l’ennemie ou l’héritière de la bienséance ?
Dr. Martin : « Les deux. D’un côté, elle sanctionne des comportements jugés grossiers ou oppressifs – ce qui rappelle les anciens codes excluant ceux qui “ne savent pas se tenir”. De l’autre, elle manque souvent de la mesure propre à la bienséance classique. La philosophe Judith Butler disait : “L’éthique commence quand on accepte de se laisser transformer par l’autre”. Or, la “cancel culture” laisse rarement cette chance. Pourtant, des plateformes comme Discord expérimentent des “cercles de réparation”, où l’auteur d’une offense peut s’excuser publiquement. C’est une piste fascinante : une bienséance restaurative. »
Author
Stay connected for new publications, events, and more.
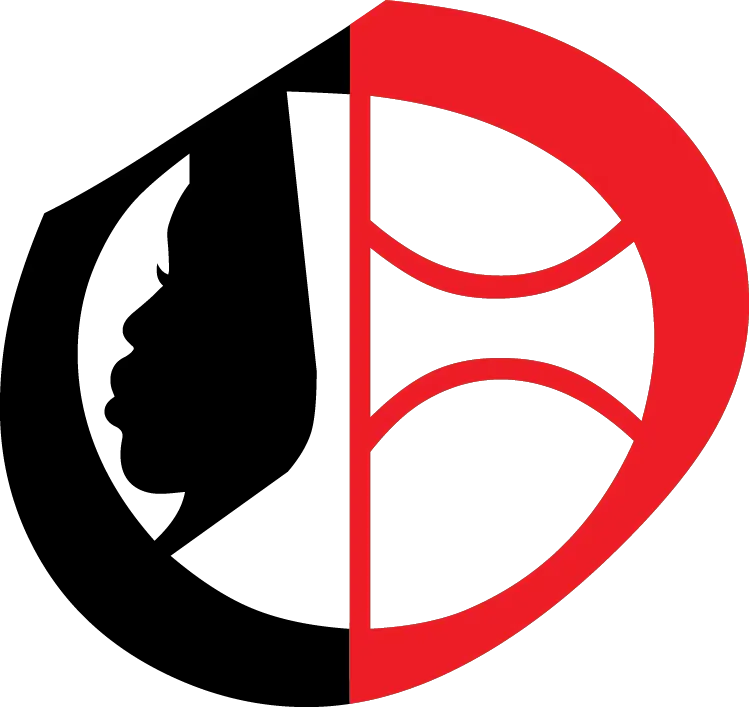


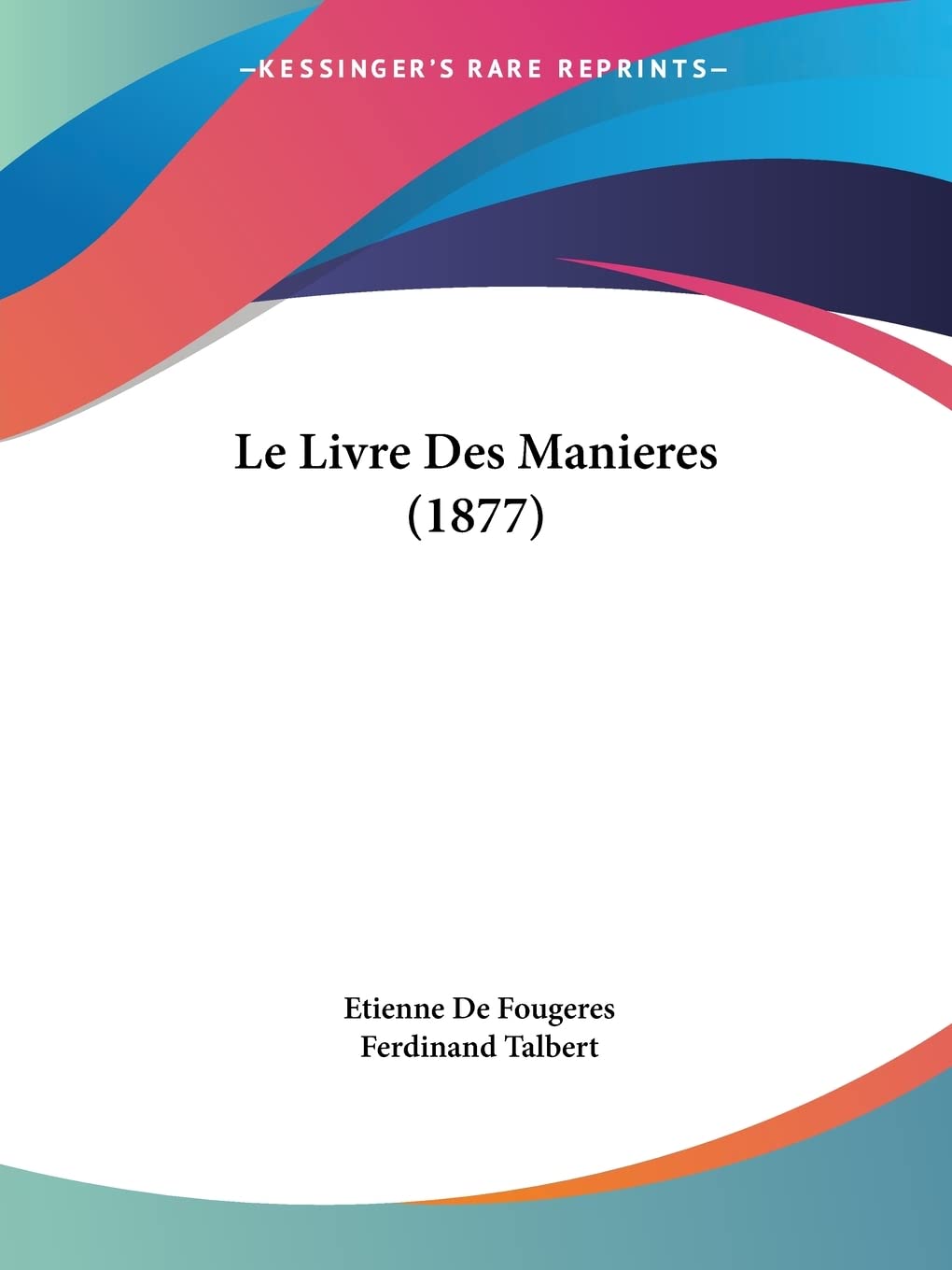


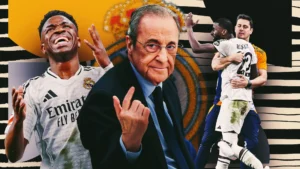
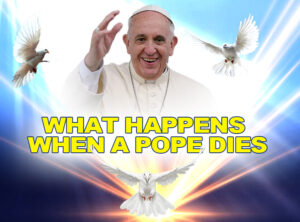
Sujet très pertinent et bien traité